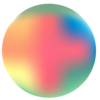Les "médiateurs" institutionnels sont-ils de véritables médiateurs ?
En France, le terme « médiateur » est largement utilisé dans les services aux consommateurs. On entend parler du médiateur partout, à tort ou à raison, pour l’énergie, pour les transports, pour l’assurance, les services publics, …. Ces fonctions sont habituellement rattachées à des entités administratives, des fédérations professionnelles ou aux entreprises elles-mêmes. Et pourtant, malgré leur appellation, ces « médiateurs » n’exercent pas, dans la plupart des cas, la médiation au sens plein du terme.
Ces médiateurs institutionnels jouent un rôle précieux puisque le mission est d’examiner les litiges entre consommateurs et entreprises, analyser les pièces du dossier, les conditions contractuelles, les lois applicables, pour ensuite émettre une recommandation. Il faut cependant noter que leur intervention se fait sans que les parties ne soient impliquées dans la recherche de la solution. En cela, leur rôle est souvent hybride, situé à mi-chemin entre l’instruction d’un dossier de réclamation et l’arbitrage non contraignant.
À l’inverse, telle que définie par le Code de procédure civile et par les grands principes internationaux (notamment ceux de la directive européenne 2008/52/CE) et telle que mené par Médiation Concorde, la médiation professionnelle est une démarche volontaire, participative, confidentielle, où un tiers neutre, indépendant et impartial accompagne les parties dans un processus structuré pour les aider à renouer le dialogue et à construire ensemble une solution qui leur appartient pleinement.
Ainsi le médiateur, au sens strict tel que défini ci-avant, n’impose rien, ne juge pas, ne tranche pas. Il agit dans l’ombre du conflit, en facilitateur de communication, pour que chaque personne soit entendue dans ses besoins, ses émotions, ses intérêts. Ce travail, mené en présentiel (ou à distance) en temps réel, redonne du pouvoir d’agir aux parties. Il permet souvent de restaurer une relation, ou à défaut, de la clore avec respect, loin de la logique de gagnant-perdant, quand ce n’est pas celui du perdant-perdant.
L’une des grandes confusions vient du fait que les deux types d’acteurs partagent le même mot — « médiateur » — alors que leur posture, leur méthode, leur rôle, et même leur légitimité ne relèvent pas de la même philosophie. Là où le médiateur professionnel anime un processus dynamique, le médiateur institutionnel analyse un dossier statique. L’un se retire du contenu pour laisser la place aux parties, l’autre interprète le contenu pour suggérer une issue. Dans le premier cas, la solution naît du dialogue. Dans le second, elle est proposée par un tiers.
Cela ne signifie pas que les médiateurs institutionnels ne soient pas utiles — au contraire, ils offrent un accès simplifié au règlement de petits litiges de consommation sans avoir recours aux tribunaux. Mais leur action ne doit pas être confondue avec la médiation relationnelle, humaine, libre et responsabilisante, telle qu’elle est pratiquée par les médiateurs formés à cette discipline exigeante.
En conclusion, il est essentiel de faire la distinction entre les deux approches :
· Le médiateur institutionnel traite un litige,
· Le médiateur professionnel accompagne des personnes.
Cette nuance change tout !